Il y a foule dans les eaux de l’Atlantique. Car les harengs se retrouvent parfois par centaines de millions. Des rassemblements sans égal dans le règne animal. C’est ce qu’on constaté une dizaine de chercheurs américains, à l’aide d’un sonar sous-marin, sur le Banc de Georges, à une centaine de kilomètres au large du Massachusetts. Les résultats ont été publié vendredi dans la revue Science (1).
Pour observer l’océan, les chercheurs disposaient d’un sonar aux dimensions spectaculaires, formé d’un navire émetteur et d’un navire récepteur, séparés de plusieurs kilomètres. Le sonar balayait une région de cent kilomètres carrés toutes les soixante-quinze secondes!
Et cet outil impressionnant a pu observer la formation d’un banc de harengs gigantesque en un peu plus de six heures. Parti de rien un peu plus d’une heure avant le coucher du soleil, le banc s’est progressivement formé, atteignant 250 millions d’individus peu après minuit. Pas moins de cinquante mille tonnes de poissons. Un trait de chalut scientifique a permis de constater que 99% des poissons étaient des harengs, le reste étant des rougets et des haddocks.
Au passage, les scientifiques ont pu suivre avec précision la formation du phénomène. La journée, les harengs forment de petits bancs qui préfèrent les eaux sombres en profondeur. Quand le soleil commence à se coucher, les groupes remontent et s’agglomèrent. Au départ, ce regroupement est lent: la densité augmente en moyenne de 0,1 animal au mètre carré par heure. Et une fois atteint un seuil critique (0,2 poisson au mètre carré), tout bascule: la densité augmente brutalement à un rythme cinquante fois plus rapide que précédemment, jusqu’à atteindre 4 animaux au mètre carré en moins d’une heure! Les harengs passent ensuite la nuit en rangs serrés, et commencent à se disperser quand la lumière revient.(2)
Pourquoi de tels rassemblements? Pour les chercheurs, qui ont aussi étudié les spécimen capturés pendant l’expérience, il s’agit probablement d’une stratégie qui favorise la reproduction. Le groupe profite de sa densité et de l’obscurité pour maximiser la fertilisation des femelles et éviter les prédateurs. Une découverte importante pour la préservation de l’espèce. Car si on pêche pendant ces rassemblements, on prélève des quantités gigantesques de poissons tout en empêchant leur reproduction.
Il y a deux siècles, les chercheurs auraient sans doute pu observer un phénomène similaires avec les morues. Mais, victimes de la surpêche, elles ont quasiment disparu du Banc de Georges. L’équipe espère croiser dans les eaux de l’Alaska, pour espionner la reproduction des colins et éviter l’effondrement de cette ressource précieuse pour nourrir les humains.
(1) Edition du 27 mars 2009
(2) La revue Science diffuse une vidéo à télécharger qui donne l’ensemble des observation au sonar pour le 3 octobre 2006.
Image: La formation du banc de harengs, au soir du 3 octobre 2006 © Science

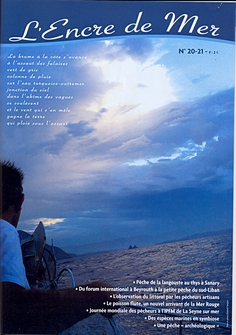 De très belles contributions dans ce numéro : réflexions sur la gestion des pêches artisanales, témoignages de l’engagement des pêcheurs pour la préservation littorale, rencontre avec des pêcheurs au sud-Liban, récit d’une expérience surprenante et réussie sur les moyens de capture des pêcheurs… il y a 8000 ans ! Mais encore deux pages de photos de l’Association Bleue-passion sur l’intimité sous-marine d’espèces qui vivent en symbiose, et un nouveau tableau en pleine page de Beate Ketterl-Asch…
De très belles contributions dans ce numéro : réflexions sur la gestion des pêches artisanales, témoignages de l’engagement des pêcheurs pour la préservation littorale, rencontre avec des pêcheurs au sud-Liban, récit d’une expérience surprenante et réussie sur les moyens de capture des pêcheurs… il y a 8000 ans ! Mais encore deux pages de photos de l’Association Bleue-passion sur l’intimité sous-marine d’espèces qui vivent en symbiose, et un nouveau tableau en pleine page de Beate Ketterl-Asch…




